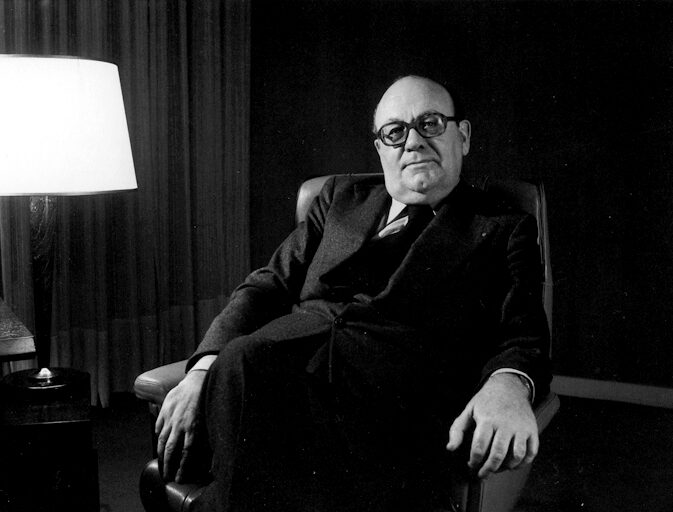Entretien avec Gérard Mordillat et Nicolas Philibert
Propos recueillis par Monique Assouline
Dossier de presse
- Janvier 1979
Comment, sur quels critères avez-vous choisi les patrons que vous avez interviewés?
Gérard Mordillat : Nous ne prétendons pas que notre choix soit représentatif de l’ensemble du patronat ! A une ou deux exceptions près, nous avonséliminé au départ les chefs de petites et moyennes entreprises, qui sont pourtant les plus nombreux, et nous nous sommes plutôt adressés à des patrons degrands groupes, parce que leurs propos ont une réelle dimension : le discoursd’un patron qui a 5 employés n’a rien à voir avec celui d’un responsable comme Jacques de Fouchier qui est, directement ou indirectement à latête de 790 000 personnes !
Nicolas philibert : Autant que possible, nous avons également cherchéparmi les patrons « éclairés », ceux qui sont à l’avant-garde et à qui il est plusdifficile d’appliquer les schémas traditionnels du « patron ». Dans le film, il n’ya que deux patrons par héritage ; les autres sont des managers qui sont salariéspar leur entreprise et qui n’en sont pas propriétaires. Certains d’entre eux ontlu Marx ou Foucault, et reprennent à leur compte certaines de leurs idées. Cesont les patrons de demain, et non pas les survivants du XIXe siècle.
Avez-vous obtenu facilement leur accord ?
G.M. – Vous savez, il y a un goût bien français pour l’étiquette. Le plusdifficile n’a pas été de leur faire accepter d’être filmés, mais d’obtenir desrendez-vous avec eux. Pour certains, il a fallu plus de 4 mois de démarches etd’explications avec plusieurs niveaux de la hiérarchie… Ça explique pourquoile tournage s’est échelonné sur près d’un an et demi.
N.P. – En fait, il y a une dynamique qui a fonctionné, telle que lorsqu’on aobtenu l’accord d’un patron, puis d’un deuxième, etc. les autres ont donné plusvolontiers le leur. Chaque fois que nous avons fini par pouvoir les rencontrer,ils ont toujours accepté…
Y a-t-il eu des refus ?
N.P. – Oui. Tous significatifs, d’ailleurs… David de Rotschild, l’un des filsdu Baron Guy, a bien voulu se laisser enregistrer au magnétophone, mais il arefusé de se laisser filmer, et il s’en est expliqué : il y a les Rotschild qui semontrent, aux courses, dans les galas, et il y a ceux qui sont à la tête desaffaires, et qui ne se montrent pas. Pour que le mythe fonctionne comme tel, ilfaut garder une part de mystère.
G.M. – David Rockefeller, parce qu’il ne venait pas en France dans cettepériode-là, mais il nous a envoyé un télégramme de New York : « Best wishesfor an interesting and education production ! »
N.P. – Nous espérions aussi Agnelli, mais il y a eu l’affaire Revelli-Beaumont… et Jacques Borel, mais du jour au lendemain, ses actionnaires luiont interdit toute prise de parole en public : chaque fois qu’il faisait unedéclaration à la presse, les actions tombaient un peu plus !
Quelle était leur attitude à votre égard?
N.P. – Ils sentaient bien que nous faisions un film critique, d’autant qu’onne le leur cachait pas. Mais le fait que nous n’ayons jamais cherché à polémiquer avec eux a du les rendre plutôt perplexes.
G.M. – La polémique, c’est le terrain pour lequel ils sont préparés, ouentraînés, mais nous ne voulions pas de ce terrain-là ! Certains d’entre euxdevaient s’attendre à ce qu’on cherche à les piéger, mais notre démarche c’étaitle contraire de la polémique : nous les rencontrions une ou deux fois avant letournage pour leur expliquer notre méthode de travail et préparer nos questions avec eux, et après le tournage nous leur montrions les rushes, et on endiscutait ensemble.
N.P. – Nous jouions au poker ouvert !
G.M. – On a presque toujours fait deux interviews avec eux. La deuxièmefois, le résultat était souvent meilleur, parce qu’entre temps ils avaient vu lesrushes et qu’on leur reposait exactement les mêmes questions.
Au fond, ils ont dû être assez flattés…
N.P. – Ils cherchaient à renvoyer la meilleure image d’eux-mêmes et del’Entreprise, en général ou en particulier ; et c’est à partir de ce moment-là queça devenait intéressant pour nous.
G.M. – Les patrons s’entraînent de plus en plus à la prise de parole, cela faitpartie de leur formation : ils travaillent la diction, les gestes, s’entraînent pourla radio et la télévision, prennent des cours, font du mime, du psychodrame,des jeux de rôles, ils jouent aux syndicalistes… et c’est ce côté « discourspublic » que nous avons cherché à obtenir d’eux. Nous avions avec eux lesmêmes rapports qu’avec des acteurs : quand ils débordaient le sujet ou répondaient à côté, nous disions « attendez, on va recommencer, vous faites unmauvais départ ».
Posiez-vous à chacun les mêmes questions ?
G.M. – Oui et non. Oui parce que nos questions se recoupaient forcémentsur les problèmes du pouvoir, de la hiérarchie, des rapports avec les syndicats,sur les grèves… Non, parce que nous adaptions nos questions en fonction dechacun.
N.P. – Nous ne voulions pas non plus enfermer le film dans une probléma-tique qui serait propre à tel ou tel type d’industrie, et c’est pourquoi nous avons choisi des personnes appartenant à des secteurs d’activités différents : textile,informatique, banque, distribution, électronique, tourisme, automo-bile, édition…
G.M. – Il y en a même un qui avait préparé son propre questionnaire pourqu’on lui pose les questions qu’il avait rédigées. Ce n’était pas du tout incompatible avec notre méthode, au contraire !
Votre travail rejoint celui d’Harris et Sédouy ?
N.P. – Ce qui nous distingue radicalement d’Harris et Sédouy c’est qu’ils sesont intéressés aux patrons en tant qu’individus, à l’aspect biogra-phique,psychologique, anecdotique, en confesseurs attendant les confiden-ces ou lesbonnes histoires. Nous, nous n’avons jamais envisagé les choses sous cetangle-là, les patrons n’étaient pour nous que les représentants d’une classesociale, et nous sommes restés sur le terrain idéologique.
G.M. – Au bout du compte, si le film est réussi, on ne doit plus savoir quiparle. Ça n’a pas d’importance, c’est un discours unique même s’il y a douzevoix pour l’exprimer. On pourrait en prendre douze autres, on ne verrait pas ladifférence…
N.P. – Les chefs d’entreprises revendiquent cet anonymat, cetteinterchangeabilité ; c’est ce qui fait leur force.
G.M. – On avait même pensé un moment faire une petite démonstration enre-synchronisant le discours de l’un dans la bouche de l’autre. C’est un peu ungag, mais je suis sûr que personne – sauf les intéressés – n’auraitperçu le changement.
Vous n’avez pas été tentés de faire appel à des ouvriers, à des syndicalistes ?
N.P. – Si. Au début, nous pensions construire le film entre ces deux pôles,discours patronal et discours syndical, mais très vite nous avons abandonnécette idée. Elle ne mène en fait qu’à une fausse dialectique, à un débatartificiel : on fait parler un patron, puis on va trouver un syndicaliste à qui onfait dire le contraire, et on monte leurs deux réponses l’une après l’autre,comme ça il y en a pour tous les goûts.
G.M. – Donner l’illusion d’un débat, c’est la meilleure façon d’empêcherles gens de réfléchir. Nous n’avons pas voulu faire un film didactique ou unethèse : la part critique du film ne se trouve pas dans un commentaire ou dans uncontre-discours, elle vient uniquement du cinéma, du choix des cadrages, dufait que nos questions n’existent plus dans le montage, des sons d’usines qui sont tous irréalistes, de la conception du montage, et surtout de la perspectivede fiction que nous avons donnée à l’ensemble.
N.P. – La critique doit se faire dans la tête des spectateurs, sans intermédiaire ni drapeau. C’est un film inconfortable.
G.M. – Je crois que c’est là qu’il faut parler de mise en scène du discourspatronal. C’est une notion très importante pour nous. Contrairement auxdéfenseurs de la veuve et de l’orphelin nous n’étions pas dans une positionaffective vis-à-vis de ceux que nous filmions. Dans un film militant, on cherchel’adhésion affective du spectateur. Nous, nous ne nous incarnions pas dans lespersonnages de notre film, ni dans le président ni dans le manoeuvre, ce qui nesignifie pas que nous soyons sans parti pris. Nous avons fait un film politique,pas un film militant !
N.P. – Oui. Dans les films militants, on veut à tout prix faire dire aux gens cequ’on a décidé à priori qu’ils diraient. C’est aussi une pratique courante à latélévision.
À quoi correspondent les plans d’usines?
N.P. – Dans le film, on peut dire qu’il y a « ce qui parle » et « ce qui ne parlepas ». Le travail, c’est « ce qui ne parle pas », mais c’est ce qui rend possible lediscours patronal. Il était important de montrer où ce discours s’exerce, dansquels lieux, de quelle façon…
G.M. – Bien sûr aussi, le travail en usine fonctionne comme opposition audiscours patronal, c’est lui qui vient l’interrompre, qui le ramène à la réalité,d’une façon brutale. Mais dans le film ce n’est pas uniquement cela : le travail,c’est une forme du discours. L’organisation du travail renvoie sans cesse àl’ordre patronal.
N.P. – Le seul thème que les patrons n’ont pas abordé, c’est le travail, soitparce que c’était complètement refoulé, soit parce qu’ils avouaient une totaleméconnaissance de ce qui se passe dans les usines. Dans le montage, les plansd’usines fonctionnent à la fois comme opposition au discours et à la fois commel’inconscient de ce discours.
Comment s’est passé le tournage dans les usines ?
G.M. – Les usines sont encore des châteaux forts, mais une fois passé le guet, ça s’est plutôt bien passé, sauf chez Citroën où on nous a empêchés defilmer un poste de travail qui n’était pourtant ni plus dur ni plus sale que lesautres… Notre accompagnateur voulait peut-être justifier son salaire.
N.P. – C’est toujours difficile de tourner dans une usine. Nous voulionssurtout éviter de faire de l’ouvriérisme et de la sentimentalité. Nous voulionsmontrer comment le travail est la plus stricte application du discours des patrons.
Vous étiez toujours accompagnés ?
G.M. – Oui. ça allait du contrôle classique, de type policier, jusqu’au badge électronique, mais toujours quelqu’un pour surveiller.
Vous parliez tout à l’heure d’une perspective de fiction…
G.M. – Le film est construit comme un récit qui va de A à Z, un peu comme si les patrons racontaient une histoire, une seule et même histoire, et dont chacun raconte un petit morceau.
N.P. – En général, les documentaires décrivent le présent ou le passé : il y a les archivistes, et ceux qui font des films-constat. Dans les deux cas, ça fonctionne sur l’événement. Dans La Voix de son maître, tout ce qu’on a tourné c’est du matériel documentaire, mais ça ne fonctionne pas sur l’événement, mais sur le discours ; pas sur le passé mais sur le futur, sur la description d’un monde futur dont les bases existent déjà, et auxquels les patrons aspirent.
G.M. – Le cinéma souffre trop des classifications. Est-ce que les films de Vertov, de Flaherty, de Wiseman ou de Perrault sont des documentaires ou tout simplement du cinéma ?
N.P. – On revient à l’idée de mise en scène, parce que le documentaire est aussi lié au hasard, à l’opportunité. Dans notre film nous avons évacué le plus possible cette dimension-là.
G.M. – Ou si c’est un documentaire, c’est un documentaire de série noire…