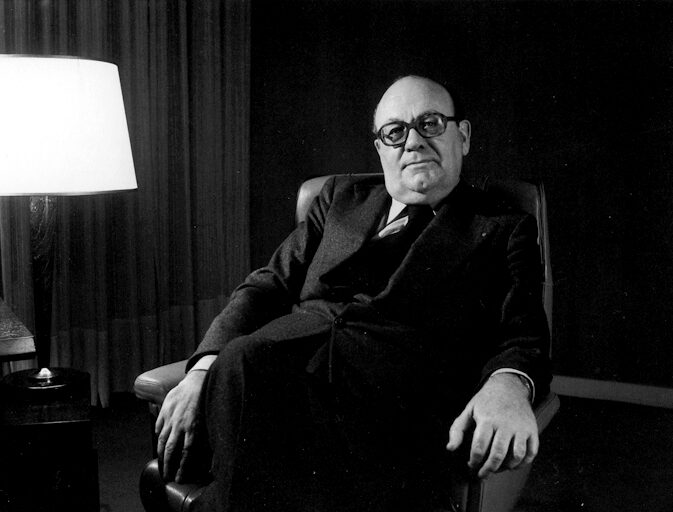Entretien avec Gérard Mordillat et Nicolas Philibert
Propos recueillis par Gildas Grimault
À l'occasion de l'édition DVD
- Septembre 2007
Nombre de documentaires jouent sur l’humour, sur l’émotion, pour faire passer un message. Pourquoi avoir refusé cette approche ?
Gérard Mordillat : Nous voulions filmer le pouvoir. Sur le plan intellectuel, nous étions dans la perspective tracée par Michel Foucault dans son cours inaugural au Collège de France, L’ordre du discours. Il montrait comment les enjeux de pouvoir sont mesurables à l’intérieur du discours. Nous nous sommes donc intéressés seulement au discours patronal sans laisser de place à l’affect, à la biographie des patrons, à leur histoire personnelle et professionnelle. Nous ne voulions pas apparaître comme leurs interlocuteurs, ni même leurs contradicteurs. Nous souhaitions les amener à théoriser face à la caméra en leur laissant le temps d’approfondir leur réflexion, en utilisant le cinéma comme outil critique.
Pensez-vous qu’il serait possible de réaliser le même travail aujourd’hui ?
Nicolas philibert : Avec le recul, il y aura probablement des gens pour trouver que « nos » patrons étaient un peu naïfs, et en déduire que leurs successeurs ne se laisseraient pas faire. Mais ce n’est pas si sûr ! Tout le monde sait aujourd’hui que l’exercice du pouvoir passe par la communication, par les images, et sur ce terrain-là, les patrons ne sont plus en reste. Ils n’hésitent pas à se montrer, ils se répandent dans les médias et affichent sans complexe leur vision du monde, alors qu’à l’époque c’était loin d’être le cas. Ils n’apparaissaient que très rarement en public, et répugnaient à le faire. Certains d’entre eux commençaient tout de même à se former, à suivre des stages pour apprendre à se comporter devant un micro ou une caméra, mais ceux-là n’étaient encore qu’une exception. Le patronat cultivait l’art du secret. Bien sûr cette dimension occulte existe encore aujourd’hui, les décisions se prennent en coulisse, mais disons que dans cette partie visible du patronat, il y a aujourd’hui un certain franc-parler là où il y avait beaucoup de retenue. Notre projet n’était pas « qu’est-ce que le capitalisme ? » mais «voilà ce que le capitalisme veut bien montrer de lui-même ». Nous leur avions proposé un « portrait ». Alors si nous devions recommencer aujourd’hui, certaines réponses seraient évidemment un peu différentes, mais je ne crois pas que ce serait impossible.
GM : Dans tous les cas, aujourd’hui comme avant, la parole est toujours mise en scène. Or, nos choix cinématographiques, la rigueur janséniste du plan fixe sans recadrage, l’espace et le temps offerts à la parole, permettaient d’entendre et de voir quelque chose que l’on ne voit pas dans la mesure où d’ordinaire les effets de cadrage, de montage font écran. Quand on entend un patron s’exprimer à travers les médias, c’est toujours extrêmement bref, rapide, enlevé pour induire le dynamisme supposé ce celui qui parle. C’est évidemment un choix de nature idéologique et politique. Au contraire, les choix que nous avons faits dans La voix de son maître brisent ces leurres en éclairant le discours patronal, en le déconstruisant, en l’analysant par l’image. Ce qui signifie qu’aujourd’hui mener un film sur le même terrain, avec la même démarche, conduirait vraisemblablement à un résultat comparable.
En laissant seuls les patrons s’exprimer, ne craigniez-vous pas que les spectateurs n’aient pas d’approches critiques ?
GM : Notre point de vue critique était clairement énoncé dans un dispositif qui avait la force de sa simplicité. Au plan fixe du patron, qui défendait la légitimité du capital et la relation des personnes dans l’entreprise, répondait le silence de ces entreprises, filmées de la même manière, dans des plans fixes qui restituaient la durée du travail. Cette question de durée est fondamentale. L’accélération artificielle produite par le montage nous empêche de réfléchir. À partir du moment où chaque geste, chaque mimique, chaque silence devient significatif et que le spectateur a le temps de voir ce qui se joue, la possibilité d’un travail critique lui est restituée. Nous rendions aux spectateurs la position critique qu’on lui dénie soit en mettant un commentaire soit en accélérant ce que l’on montre. Avec nos plans longs de la chaîne, on comprend la traduction en acte et en geste du discours patronal sur le travail des ouvriers.
NP : Tout le contraire de ces films militants – nombreux dans cette période post-soixante-huitarde – où les slogans tenaient souvent lieu de pensée. Prenez Michael Moore aujourd’hui. Il joue constamment sur l’émotion, le sensationnel. La Voix de son maître c’était le contraire du spectacle : une forme austère, sèche, qui ne cherchait ni l’exagération ni l’adhésion affective du spectateur. Avec un sujet comme le nôtre – les patrons – nous aurions pu verser dans la caricature : succès garanti ! Mais il n’en était pas question.
Est-ce que cette démarche a toujours été comprise ?
GM : Je me souviens d’une présentation du film à des cadres de la CFDT. Le présentateur a commencé la séance en se demandant si les ouvriers allaient comprendre. Nous avons aussitôt quitté la salle, ils ont dû nous rattraper dans le hall ! Les présupposés de ce présentateur sont malheureusement le reflet d’une opinion assez répandue sur la passivité stupide du spectateur. Encore une fois, notre film, c’est tout le contraire.
NP : Le film était un outil de réflexion pour ceux qui voulaient s’en emparer. Il a eu une double carrière : d’abord en salle, dans le circuit art et essai, puis dans les comités d’entreprises, les réseaux associatifs, les syndicats, et même dans des écoles de commerce. Cette seconde vie, souvent accompagnée de débats, nous a mobilisés pendant un an. Il nous est arrivé d’aller dans les entreprises où nous avions tourné, ou dans des usines en grève.
GM : Chez Michelin, on a même été mis à la porte par les vigiles et les cadres qui refusaient au comité d’entreprise le droit d’organiser une projection à l’intérieur des locaux en plein conflit social.
On est surpris dans votre film par la nécessité des patrons de se justifier, comme si la société entière leur imposait de répondre…
NP : Une parole est toujours le produit de son époque. Aujourd’hui les patrons parlent de façon décomplexée, ils affichent leur propre jouissance. Prenez le mot « profit » : il était presque inexistant dans leur bouche. C’était tabou. Mais rappelez-vous, les syndicats étaient bien plus puissants. Les années 80 ont constitué un premier tournant. L’apparition de chefs d’entreprises comme Bernard Tapie puis Jean-Marie Messier sur les plateaux de télévision a conduit à un étalage sans vergogne du profit, de la réussite. En même temps, ce cynisme va de pair avec une recherche de consensus. Quand les patrons parlent du profit, ils précisent toujours que c’est pour le bien de tous.
GM : Il y a eu un changement sémantique très important. À l’époque du tournage, toutes les entreprises avaient un « chef du personnel ». Dix ans plus tard, elles ont un « directeur des ressources humaines », le fameux DRH. On est passé d’un discours humaniste-paternaliste sur les salariés, à un discours commercial et économique. Il ne s’agit plus de diriger des individus mais de gérer des ressources. Le salarié est pensé comme une marchandise.
NP : La disparition du chef du personnel au profit du « DRH » participe de cette offensive linguistique, de cette contamination néo-libérale du vocabulaire qui tend à vider certains mots de leur substance et à faire disparaître de la langue tout ce qui pourrait incarner l’idée d’exploitation, de division, d’affrontement social ou idéologique. C’est ce que développe Eric Hazan dans son livre sur la LQR, pour Lingua Quintae Respublicae. On ne parle plus aujourd’hui de lutte des classes, ni même de classes et surtout pas de luttes. On dira « couches sociales », « catégories socioprofessionnelles », et au « 20 heures », on annoncera qu’une rencontre vient d’avoir lieu entre « partenaires sociaux ». Il s’agit d’accréditer l’idée que nous sommes tous solidaires, tous dans le même bateau ! Il n’y a plus de pauvres mais des personnes de condition modeste. Les exclus ont remplacé les exploités. La compassion a pris le pas sur la révolte.
L’importance des mots apparaît au début du film avec le débat autour du le titre ?
NP : On se rend compte que finalement, les chefs d’entreprises aimaient bien le mot « patron », son côté familier. Ils se disaient « fiers et heureux » quand on les appelaient « patron ». Dans La Voix de son maître, c’est évidemment le mot maître, la relation maître/esclave ou maître/chien qu’elle induit qui les dérangeait.
GM : Le titre La voix de son maître avait horrifié, voire scandalisé Jacques Beyle, à la tête d’un institut de recherches patronales à Jouy-en-Josas. Nous lui avons proposé de réunir plusieurs chefs d’entreprise pour trouver un autre titre. Le jour du tournage, au préalable, nous avons expliqué aux patrons qui avaient accepté le défi, qu’en tant que cinéastes nous aussi avions des contraintes économiques et sociales. Nous étions à la tête d’une entreprise de cinéma, nous payions des salaires, notre travail avait un but commercial puisque le film était appelé à sortir en salles et à être diffusé à la télévision. Il était donc hors de question de se satisfaire d’un titre rébarbatif du genre Aspect du patronat en 1977 ou Le management moderne de l’entreprise. Après quatre heures de tournage, ils étaient arrivés au titre Les Gagneurs… L’alternative était simple : leur titre ou le nôtre ? Finalement La voix de son maître leur a paru un moindre mal.
Face aux évolutions de l’entreprise, est-il toujours pertinent de pointer du doigt les chefs d’entreprise ? Ne sont-ils pas finalement eux aussi des fusibles ?
GM : À l’époque la part de l’actionnariat n’était pas aussi importante. Les objectifs de l’entreprise primaient sur ceux de l’actionnariat. Le projet industriel était mis en avant. Il s’agissait de construire, de vendre… Avec la prise de pouvoir par les actionnaires, le financier a pris le pas sur l’industriel. L’enjeu est désormais – quelques soient les moyens mis en œuvre, licenciements, délocalisations etc – d’atteindre le taux de rentabilité réclamé par l’actionnariat. De fait, cela modifie la fonction des dirigeants d’entreprise et leur discours. Le pouvoir des chefs d’entreprise ne repose plus prioritairement sur leurs capacités industrielles mais sur leur réussite financière. Ce qui est dramatique c’est que la dimension humaine de l’entreprise devient un des leviers privilégiés pour obtenir la rentabilité voulue.
NP : L’image du patron était aussi associée à la présence beaucoup plus massive de l’outil industriel. Comme chacun sait, une partie de l’industrie « sale », des usines, est désormais à des milliers de kilomètres de chez nous. Cela joue forcément sur les images, les paysages, le physique des gens, les vêtements, sur la représentation.
GM : Il existait un enracinement. Le capitalisme est devenu invisible. C’est LA question qui se pose aux syndicats qui réfléchissent encore trop souvent sur des modèles héritées du XIXe siècle. En premier : intervenir sur la production, la bloquer par la grève. Mais comment agir quand la firme Total, par exemple, dégage des milliards de profits en spéculant sur le prix du pétrole entre son extraction et son raffinement, sans qu’il y ait transformation de la matière première. Vous ne pouvez donc plus intervenir sur la production. Avant en stoppant la production, les ouvriers, les syndicats pouvaient établir un rapport de force, rétablir une sorte d’égalité. Aujourd’hui, il n’y a plus de moyen d’arrêter la production. On en perçoit d’ailleurs les prémisses dans notre travail. Le patron d’IBM, dans une partie du film non montée, nous expliquait comment ils avaient des sous-traitants à Nice et à Sarreguemines qui fabriquait exactement les mêmes choses. Ces usines étaient également répliquées en Espagne et au Portugal. Donc, en cas de conflit social dans l’une, on s’approvisionnait chez l’autre, et si les deux étaient en conflit, on se tournait vers l’Espagne ou le Portugal. Cela ruinait par avance toute velléité de lutte, de conflit. Autre exemple, en 2003, les ouvriers de Métaleurop ont découvert que le propriétaire de l’entreprise n’était pas celui qu’il croyait. L’entreprise appartenait en réalité à une société américaine elle-même émanation d’une dizaine d’autres établies aux îles Caïman. C’est à dire : inatteignables ! On peut mener un assaut contre un mur, c’est très difficile de combattre un vide…
NP : Cette dimension d’invisibilité pointait déjà à la fin de notre film lorsque Guy Brana, le PDG de Thomson-Brandt, évoquait l’anonymat (du capital) comme étant «une force», une perspective d’avenir ! Aujourd’hui, avec les délocalisations, la dilution de l’actionnariat, les fonds de pension, on y est complètement, tout est désincarné. Nous n’avons plus d’images de l’industrie sous nous propres yeux. Elle ne font plus partie de notre univers visuel. Cette dimension immatérielle, abstraite, rendrait très passionnant un projet de film qui tenterait d’en rendre compte. Ce serait un beau défi pour un cinéaste.
GM : Tout cela à des conséquences sociologiques profondes. Qui dit destruction du tissu industriel, dit destruction du savoir ouvrier. On arrive de plus en plus à ce que souhaite le Medef, des gens bons à tout et bons à rien, corvéables à merci. Avant il existait une intelligence ouvrière qui activait son savoir dans les conflits sociaux. À partir du moment où il n’y a plus de culture, plus de savoir, plus d’intelligence, on a une masse anonyme mobilisable ponctuellement pour des taches ponctuelles. Notre projet en tant que projet cinématographique interpellait le savoir du spectateur. Le spectateur était amené à réfléchir. Or pour tout gouvernement, pousser les citoyens à réfléchir représente toujours un danger. La charge provocatrice de La Voix de son maître n’est pas à chercher ailleurs…